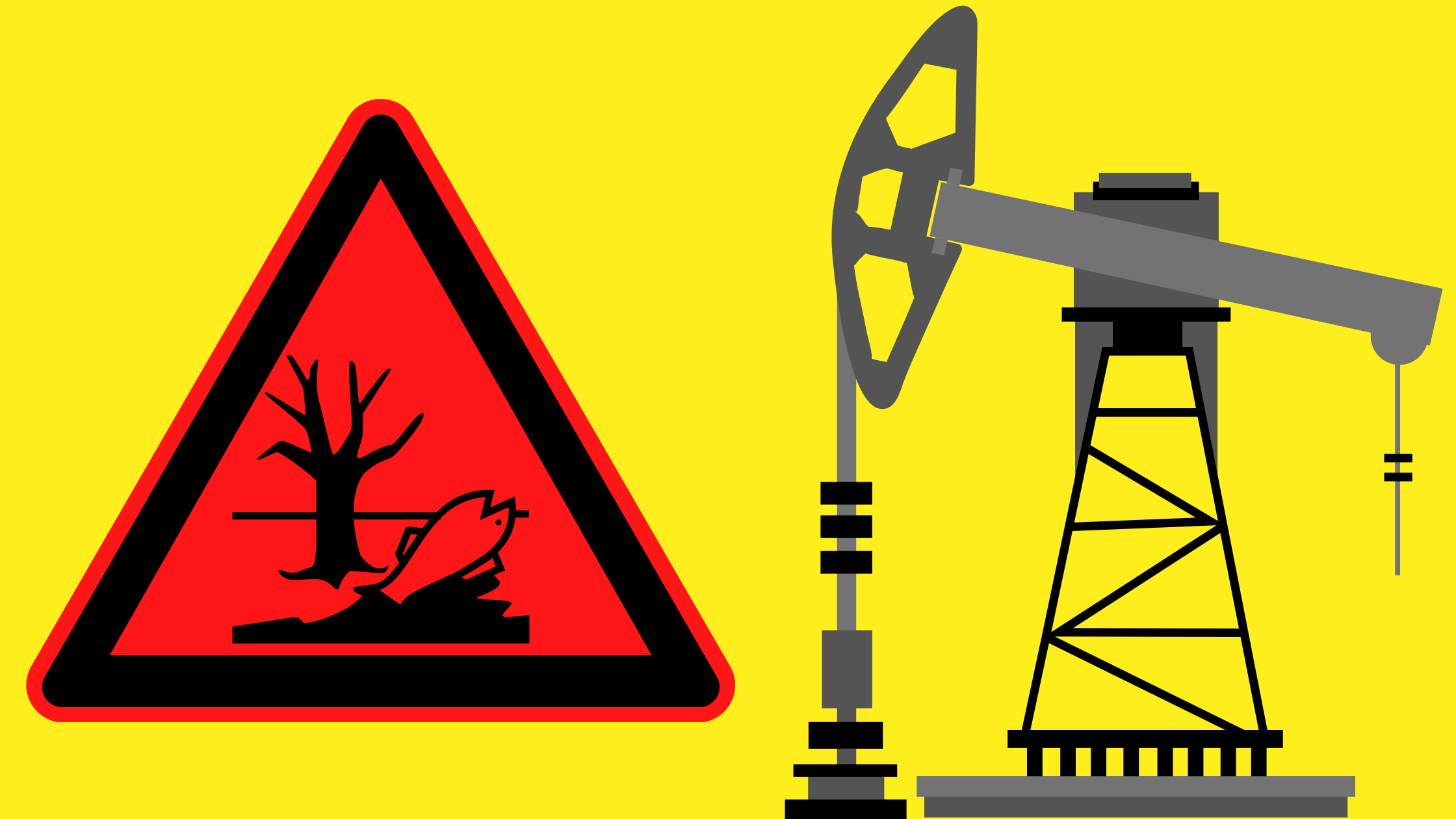Crédit visuel : Nisrine Nail – Directrice artistique
Article rédigé par Johan Savoy – Chef de pupitre Sport et bien-être
Nombre d’universités nord-américaines ont dernièrement fait le choix de retirer leurs investissements des combustibles fossiles, et notamment celle de Toronto qui a récemment annoncé son intention de s’en départir d’ici à 2030. Des étudiant.e.s de l’Université d’Ottawa (U d’O) militent pour que leur établissement emboîte le pas mais, même si certains efforts ont déjà été réalisés, la situation en est toujours à l’heure actuelle au stade des pourparlers.
Dernière en date à avoir déclaré son engagement de retirer ses investissements des énergies fossiles, l’Université de Toronto ne fait pourtant pas office de pionnière sur le continent nord-américain. Au Canada, l’Université de Victoria a fait ce choix en février dernier alors que l’Université Concordia et l’UQAM avaient, elles, pris cette décision au cours de l’année 2019. Plus anciennement encore, l’Université Laval avait ouvert la voie en 2017, annonçant rediriger ses investissements vers les énergies renouvelables.
Aux États-Unis, l’Université Harvard annonçait le retrait de ses investissements des combustibles fossiles en septembre dernier, après des années de militantisme étudiant. Une annonce qui a d’ailleurs fait boule de neige puisque l’Université de Boston et celle du Minnesota se sont glissées dans le sillage de la prestigieuse institution sur le cap de la responsabilisation en matière de placement.
Qu’en est-il à l’U d’O ?
Tim Gulliver, président du Syndicat étudiant de l’U d’O (SÉUO), rappelle qu’en ce qui concerne l’établissement uottavien, le débat a été initié en 2013 par le mouvement étudiant : « La fédération étudiante travaillait avec le club [uOttawa sans fossiles], à l’époque, pour pousser l’Université vers le désinvestissement des énergies fossiles. »
Le Conseil des gouverneurs s’était alors engagé, en 2016, à réaliser un retrait progressif avec une révision aux cinq ans, tout en affirmant sa volonté de rester investi dans certaines compagnies en relation avec les énergies non renouvelables. « Une décision motivée par le rapport d’une experte qui indiquait que le désinvestissement n’était pas la meilleure stratégie à adopter », précise Jacob Hendren, membre du club Justice climatique uOttawa. Il ajoute que les conclusions dudit rapport mentionnaient que le fait de rester investi au sein de certaines compagnies permettait d’influencer leurs décisions.
Face à l’ampleur des mobilisations pour le climat en 2019, le Syndicat étudiant avait alors décidé de demander à l’Université, par le biais d’une motion, de publier « une mise à jour concernant le désinvestissement des entreprises de combustibles fossiles ». Une demande qui trouvait finalement réponse dans la déclaration faite par l’Université le 29 octobre dernier, celle-ci indiquant « qu’à peine 1,8 % du portefeuille d’investissement [demeuraient] liés aux énergies fossiles » et que « plus de 94 millions de dollars, soit 9,2 % [des investissements] » avaient d’ores et déjà été détournés.
« [Cette déclaration] est une très bonne nouvelle, mais nous voulons que les chiffres descendent à zéro », rétorque cependant Gulliver, ajoutant que la volonté du Syndicat est de voir l’Université dénoncer les industries responsables de la situation climatique actuelle et non pas de continuer à les financer.
Hendren précise, quant à lui, que « ces 1,8 % représentent tout de même 18 millions de dollars d’investissement » et affirme que si l’Université est capable d’une telle diminution, alors elle devrait poursuivre dans cette voie jusqu’à atteindre une proportion nulle de son portefeuille de placement en matière d’énergie non renouvelable.
Et maintenant ?
Reconnaissant donc les progrès non négligeables réalisés par l’U d’O en matière de désinvestissement, Gulliver affirme cependant que la transition est un processus qui doit avoir une fin. « Nous devons [être en mesure de déterminer] une date de fin, nous ne pouvons pas être en transition indéfiniment », appuie-t-il.
Le Bureau des gouverneurs a d’ailleurs prévu de reconsidérer le sujet en janvier 2022, par le biais d’un groupe de travail, selon Hendren, qui espère également voir de son côté la situation continuer à évoluer. « Si une université aussi importante que celle de Toronto est capable de le faire, il n’y aucune raison que nous ne soyons pas en mesure d’en faire autant », ajoute-t-il, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une question de faisabilité mais plutôt de volonté.
« La stratégie de vouloir rester actionnaire de compagnies de combustibles fossiles ne marche pas », déplore finalement Hendren, constatant que « les promesses faites par les pétrolières à propos d’une réorientation de leurs activités » ne sont pour l’instant que des paroles en l’air.
« Nous espérons avoir une annonce avant la fin de l’année académique », déclare Gulliver, ce qui permettrait, selon lui, de rassurer les nombreux.ses. étudiant.e.s ayant travaillé pendant des années sur le dossier. « Ce sujet ne doit pas être confrontationnel, mais l’Université doit tenir sa parole et nous donner une date de fin », conclut-il.
L’U d’O dispose donc de nombreux exemples à travers le pays afin de se départir définitivement de ses investissements dans les énergies fossiles. Bien qu’ayant affiché à plusieurs reprises sa volonté de contribuer aux efforts en matière de lutte contre les changements climatiques, reste à voir jusqu’où celle-ci est prête à aller.