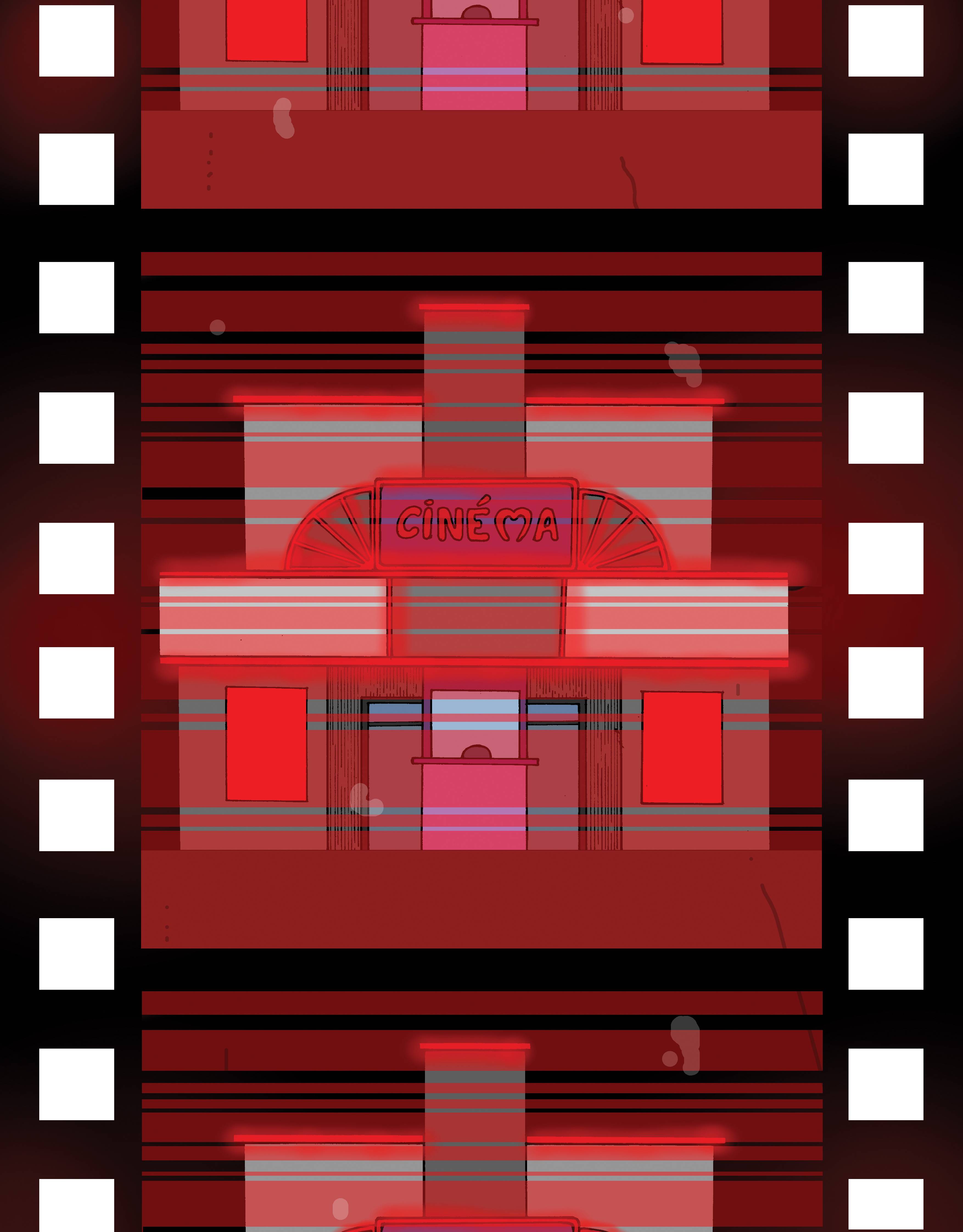
Soirée cinéma : Le commerce du sexe, pari gagnant du cinéma activiste
Par Yasmine Mehdi
Mercredi soir, salle Jean-Despréz. Plus de 250 personnes de tous les horizons sont rivées devant un écran. Étudiants, retraités, travailleurs communautaires, politiciens, criminologues et policiers étaient de la partie pour assister à la projection du documentaire Le commerce du Sexe. Si Ève Lamont, réalisatrice, a tenu à rappeler que son film était une version adoucie de la réalité, il n’en demeure pas moins que les spectateurs ont été plongés tête première dans le milieu occulte de la prostitution au Québec.
UN DOCUMENTAIRE BOULEVERSANT
Réaliste sans être voyeuriste, le documentaire met en relief les témoignages troublants de travailleuses du sexe, mais aussi de clients, de proxénètes, de producteurs de films pornographiques et de policiers.
Au gré d’entrevues, mais aussi de caméras cachées, le spectateur est amené à découvrir une réalité complexe mêlant trafic humain, violence, problèmes de consommation, crime organisé et exploitation des communautés racialisées.
À la fin de la projection, la créatrice a entamé une période de questions-réponses avec les spectateurs, déclarant d’emblée : « Ce n’est pas un film joyeux, mais croyez-moi, c’est plus soft que la réalité. »
Plus tard, Lamont a expliqué que de montrer des images plus crues aurait été contre-productif puisque les spectateurs auraient pris son travail moins au sérieux, en se disant qu’elle dramatisait : « La réalité est dramatique, mais je ne pouvais pas en faire un copier-coller parce que ça l’aurait été se tirer dans le pied. »
La cinéaste d’origine gatinoise a parcouru le Québec pour rencontrer divers intervenants, en espérant pouvoir révéler l’engrenage complexe de l’industrie du sexe : « Dans la mesure où on en révèle le fonctionnement, ça permet d’avoir un portrait de la situation […] et d’ouvrir la discussion pour penser à une solution », a expliqué Lamont.
ÈVE LAMONT, UNE ACTIVISTE ENDURCIE
Ce n’est pas la première fois que Lamont se penche sur le sujet de la prostitution. L’Imposture, son documentaire paru en 2010, portait principalement sur le témoignage d’anciennes travailleuses du sexe. C’est en ce sens qu’il diffère avec Le commerce du sexe, dans lequel la créatrice explore plutôt le rôle de plusieurs intervenants.
« Quand on pense prostitution, on pense tout de suite à l’image d’une femme aguichante, sexy et épanouie sexuellement, alors que c’est une imposture. J’ai décidé de diriger les projecteurs sur ceux qu’on ne voit pas, mais qui sont la racine de tout ça », a expliqué Lamont.
La réalisatrice, qui se considère féministe, écologiste, anticolonialiste, antiraciste et ancienne anarchiste, a confié que son militantisme était un résultat naturel de son travail de recherche : « Je n’ai jamais fait autant de recherches pour un seul sujet. […] À la lumière de tous les récits que j’ai entendus, c’était impossible de ne pas me positionner. »
D’ailleurs, c’est une position sans équivoque que Lamont prend en comparant la prostitution à une forme d’esclavage moderne. La cinéaste applaudit le modèle suédois, où la prostitution est légale, mais où la consommation de celle-ci est criminelle. « Le plus important est de ne pas blâmer ces femmes », a-t-elle ajouté.
Militante antiapartheid dans les années 80, Lamont a de plus en plus conscience de l’influence de ses films. En effet, la réalisatrice rappelle que c’est après avoir vu L’imposture que le Conseil du statut de la femme du Québec a publié un avis sur la prostitution condamnant l’industrie du sexe et appelant à l’action. Elle ne se fait toutefois pas d’illusions : « Un film ne règle pas un problème, mais il peut quand même participer à une réflexion. »
