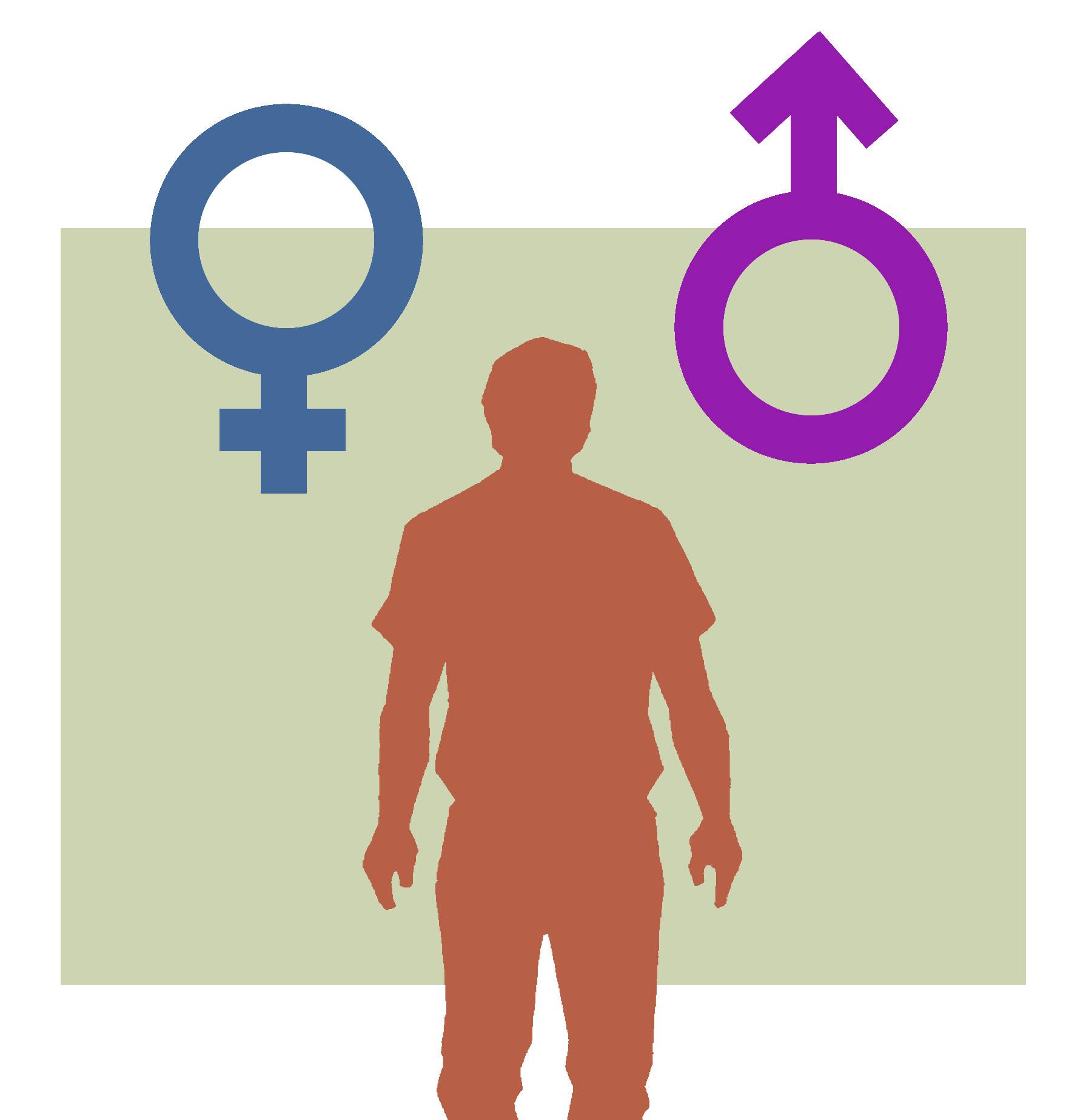Actualités
Par : Stéphanie Bacher- Journaliste
L’écriture inclusive est une règle d’écriture qui vise à lutter contre la discrimination et les inégalités de genre en assurant une représentation égale entre les femmes et les hommes dans les règles d’accord et de conjugaison de la langue française. Cette pratique de l’écriture inclusive est de plus en plus courante de nos jours. Par exemple, dans sa dernière mise à jour, le logiciel Word a inclus une option qui favorise une écriture inclusive dans le but de cibler « le langage genré à même d’exclure, de rejeter ou de stéréotyper ». La Rotonde revient sur son application et son utilisation en milieu universitaire.
Une pratique fréquente, mais non règlementée
Néomie Duval, gestionnaire des relations avec les médias de l’Université d’Ottawa fait savoir dans un courriel à La Rotonde que l’U d’O explore actuellement le sujet de l’écriture inclusive, mais que l’Université ne possède pas de règlement scolaire spécifique à la question. Elle explique néanmoins que « le SAEA [Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage] se penche sur la possibilité d’un curriculum inclusif », mais qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.
L’Université d’Ottawa compte cependant un règlement administratif sur la neutralisation et féminisation des textes. Duval assure également qu’aucun « règlement académique n’interdit à un étudiant d’utiliser une écriture inclusive ». Ainsi, aucune sanction ou pénalité ne pourrait être adressée à un.e étudiant.e qui recourt à ce type d’écriture lors d’un examen ou d’un travail de session.
La féminisation de la langue : « c’est non négociable » !
Lucie Joubert, directrice du Département de français, reconnait également qu’il n’existe pas encore de telle politique dans son département, mais que depuis qu’elle en est la directrice, elle utilise des formules telles que « chères collègues, chers collègues, les étudiant-e-s ». Elle indique également que ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des professeurs du département et que « sur le plan strictement personnel, comme professeure et féministe », elle a toujours tenu à marquer le féminin. Pour elle, « c’est non négociable » même si on lui a déjà fait la remarque que c’était un peu pénible à lire.
Au niveau des associations étudiantes, Leila Moumouni-Tchouassi, vice-présidente aux affaires de l’équité de la Fédération Étudiante de l’Université d’Ottawa, a souligné que « généralement, [on voit] les deux [langues] dans les documents de la Fédération parce qu’il y a toujours du travail qui doit être fait […] sur l’inclusivité ». La GSAÉD n’a quant à elle pas voulu se prononcer sur le sujet.