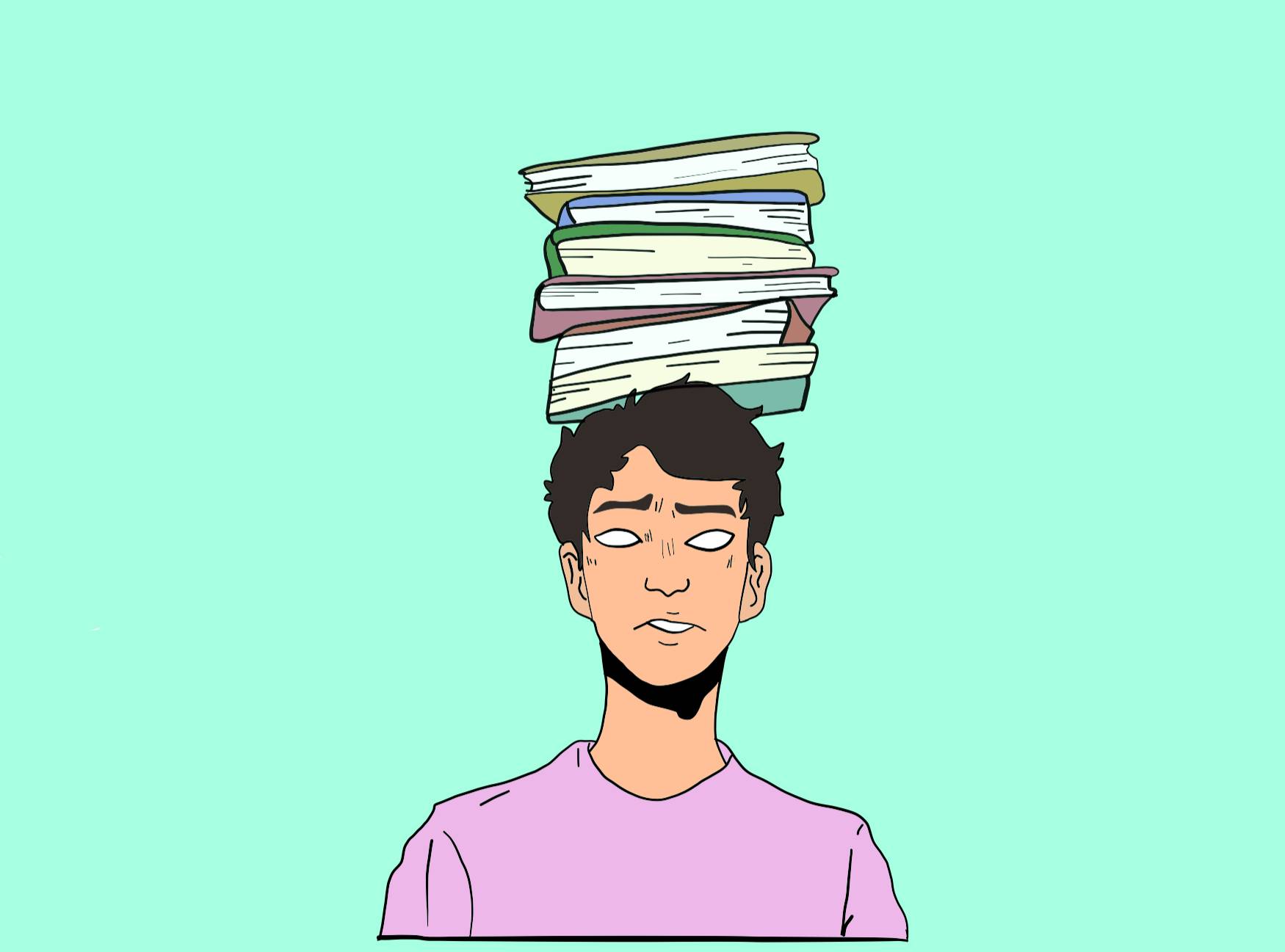Crédit visuel : Nisrine Nail – Directrice artistique
Par Miléna Frachebois – Cheffe du pupitre Actualités
Le semestre a commencé il y a moins d’un mois, et les cours en ligne soulèvent déjà le problème d’une charge de travail démesurée. Le 24 septembre dernier, l’étudiant Nelson Mahmoudi a partagé une lettre ouverte intitulée Our New World dans laquelle il fait part de son expérience en ligne et demande une prise de conscience de la part des professeur.e.s.
La lettre, rédigée par l‘étudiant de troisième année en histoire et en sciences politiques, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Elle introduit notamment un sujet important, celui du rapport des étudiant.e.s à l’apprentissage en ligne. En dehors du format virtuel en tant que tel, y a-t-il un changement à constater dans la façon d’enseigner et d’apprendre ? Si oui, qu’implique ce changement ?
L’accumulation de « petites » additions
Malgré la soustraction des déplacements physiques, les étudiant.e.s remarquent que les cours sont plus longs. Mahmoudi affirme que « certain.e.s professeur.e.s ont l’habitude de s’ajouter du temps. Si le cours doit durer 1h20, des fois il dure 1h30 ou 1h40. Mais ces dix minutes sont importantes car on les prend pour nous, manger, aller aux toilettes ».
Ghada Abid, étudiante de troisième année en développement international et mondialisation avec une mineure en économie, constate la même chose. « J’avais un cours où le professeur débordait. Je lui avais fait la remarque sur le chat car personne n’osait », livre-t-elle.
En dehors du temps dédié à la lecture, la charge de travail elle-même semble s’être accrue. Abid reconnaît avoir deux fois plus de travail que l’an passé. Elle, qui étudie tous les jours, se considère désormais comme « en retard dans tous les cours ». La charge de travail augmente rapidement car, pour elle, la participation se transforme en devoirs additionnels.
S’ajoutent à cela des questions auxquelles il faut répondre sur Brightspace, des vidéos à regarder, et des lectures à faire. Selon Mahmoudi, c’est un syllabus de cours plus fourni, et avec plus de tâches hebdomadaires qui a vu le jour.
Pourquoi empiler autant de tâches les unes sur les autres ? Pour garder les étudiant.e.s engagé.e.s, explique le professeur d’histoire Thomas Boogaart. « La littérature souligne que vous avez besoin d’un apprentissage actif et d’une présence professorale, donc […] certain.e.s professeur.e.s pourraient combiner les lectures d’un cours magistral avec les activités de discussion et les devoirs d’un cours entièrement en ligne », annonce-t-il.
Une multitude de défis
La grande problématique liée à ce format virtuel réside dans la nécessité d’être autodidacte. Cette difficulté peut contribuer, en grande partie, à la sensation de surcharge exprimée par les étudiant.e.s.
Boogaart explique que si les cours magistraux sont efficaces en temps normal, c’est parce qu’un.e expert.e distille le matériel pour l’étudiant.e. Néanmoins, si les cours autodidactes demandent plus de rigueur, c’est avec eux que l’on « apprend plus profondément et que l’on se souvient davantage après avoir terminé le cours ». Un effort d’adaptation qui n’est pas de tout repos pour beaucoup.
Cette sensation de débordement est le produit de beaucoup de facteurs, qui influent sur le travail en lui-même.
Abid mentionne que les espaces de travail à l’université sont actuellement très limités en nombre, et qu’il peut parfois être compliqué de développer un environnement d’étude sain chez soi. Mahmoudi poursuit : « il y a le stress de la COVID, du travail, des relations amicales et amoureuses ».
Pour Boogaart, ce qui pèse, c’est la « maîtrise de l’environnement d’apprentissage virtuel ». Il s’agit donc d’un ensemble de paramètres qu’il faut prendre en compte pour évaluer la difficulté des élèves à s’adapter à leur nouveau mode d’étude, de travail, mais aussi de vie.
De possibles solutions ?
Alors que les cours de ce semestre sont déjà bien entamés, il semble difficile d’envisager beaucoup de changements. Quelques ajustements, notamment le retrait d’une dissertation du syllabus par un professeur, ont cependant pu être observés en réaction à la lettre de Mahmoudi, qui appelle à la « flexibilité » des enseignant.e.s.
Abid propose quant à elle de réduire la fréquence des devoirs à rendre, et de rendre la note de participation optionnelle. Pour elle, c’est la santé mentale des étudiant.e.s qui est en jeu.
Puisque le trimestre d’hiver sera également offert en ligne, il convient de trouver des méthodes de travail et d’apprentissage adéquates pour l’ensemble de la communauté universitaire. La recherche de compromis s’annonce inéluctable.