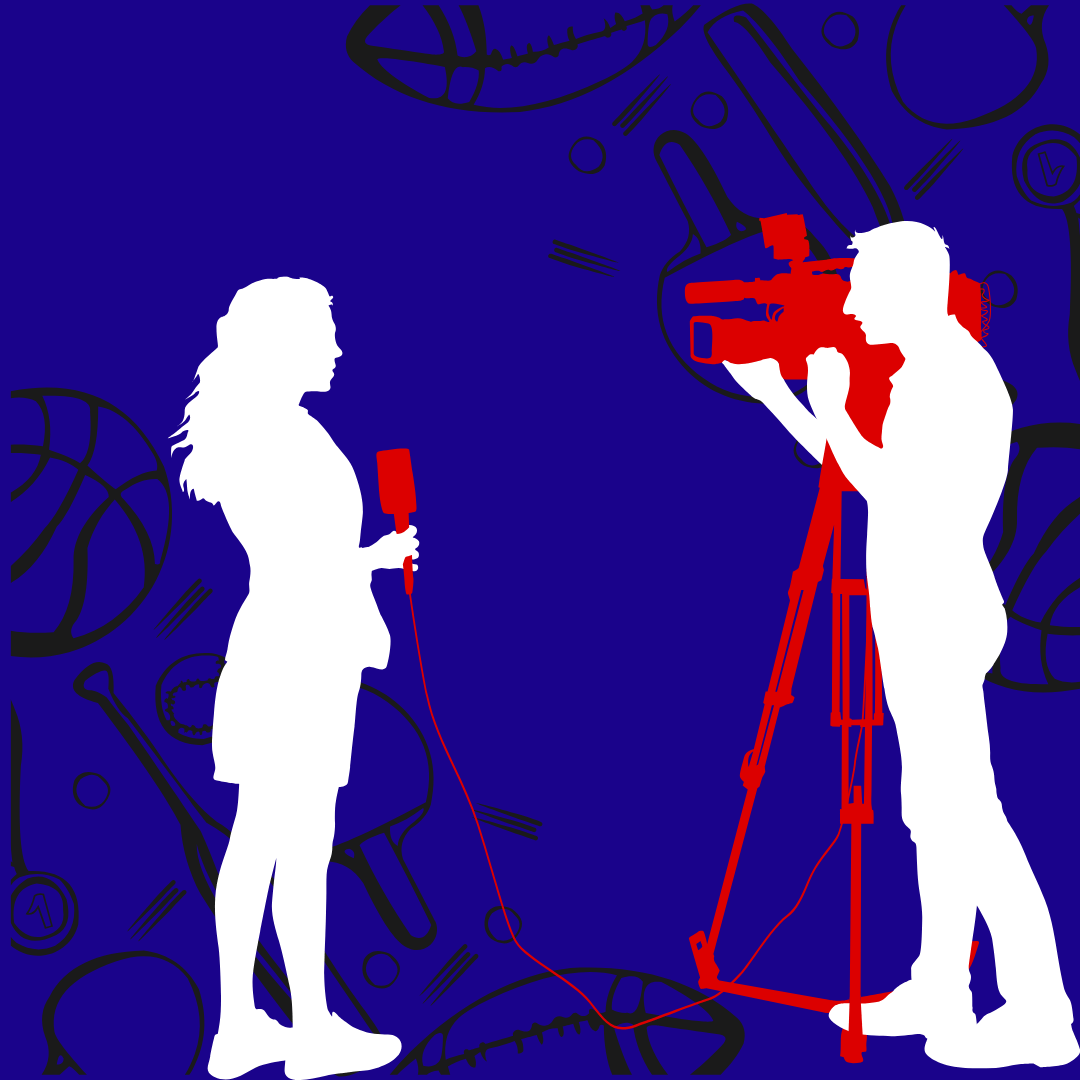
Femmes en journalisme sportif, une présence qui dérange
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Chronique rédigée par Charlie Correia — Journaliste
Les femmes se frayent de plus en plus un chemin dans le domaine journalistique. De rédactrice en chef à journaliste, en passant par cheffe d’antenne, elles occupent actuellement des postes clés dans les médias canadiens. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Et qu’en est-il du journalisme sportif ? Quelle place y occupent-elles réellement ?
Le monde du sport me fascine depuis que je suis jeune. Ce que j’ai longtemps ignoré, c’est que derrière la caméra se cachaient de nombreux obstacles que les femmes journalistes sportives que j’admirais devaient affronter. Des parcours de combattantes !
Le journalisme sportif a longtemps été un domaine réservé aux hommes. Après tout, le sport, c’est une affaire d’hommes… qu’est-ce qu’une femme ferait dans ce domaine ? C’est du moins ce que nombre de femmes ont entendu lorsqu’elles ont osé franchir les barrières de ce milieu, que ce soit en tant que journalistes ou athlètes.
Les portes qui bloquaient le chemin des aspirantes journalistes sportives ont été mises au sol par de nombreuses femmes inspirantes qui ont prouvé qu’elles avaient leur place dans cet univers. Parce que non, contrairement à ce que plusieurs imaginent, une femme n’est pas journaliste parce qu’elle est jolie et va rendre le téléjournal plaisant à regarder. Elle est là grâce à son travail acharné et son talent, comme l’homme avec qui elle partage l’antenne.
Ouvrir la voie
Autrefois, l’esthétique occupait une place primordiale dans les médias et les journaux. Les animateurs de télévision accordaient une grande importance au visuel, où l’apparence et la beauté étaient des critères essentiels. Dans le domaine du journalisme sportif, les femmes étaient largement exclues, car la croyance populaire voulait que le sport soit un univers réservé aux hommes. Ce milieu était un véritable boys club, et bien que la situation ait évolué, certains aspects du sport demeurent encore aujourd’hui empreints de cette mentalité, tant pour les journalistes que pour les femmes passionnées de sport.
Le paysage sportif est en pleine transformation. Ce n’est plus un cercle exclusivement masculin comme autrefois. Grâce aux femmes qui continuent de faire leur place avec passion et détermination, et à celles qui ont pavé la voie en brisant les barrières, le sport devient un espace plus inclusif et ouvert à tous.
Pour ma part, marcher dans les pas de ces pionnières est un privilège. Je lève mon chapeau au courage et à la persévérance dont ces femmes ont fait preuve et c’est avec une grande fierté que j’aspire à être comme elles.
« Tu ne m’impressionnes pas »
En 1989, à 24 ans, Chantal Machabée marquait l’histoire en devenant la première femme à présenter un bulletin sportif. Elle a également marqué les esprits en étant une des premières à entrer dans le vestiaire des joueurs après un match de hockey.
Dans un épisode du podcast La Poche bleue, elle raconte qu’une fois, Shayne Corson, ancien joueur des Canadiens de Montréal, se promenait nu et lui a lancé des boules de tape pour bâton pour attirer son attention. À la fin de son entrevue avec un autre joueur, elle s’est retourné et a regardé Corson de la tête au pied en lui disant : « Tu ne m’impressionnes pas ». Machabée ne s’est pas laissé marcher sur les pieds et a prouvé aux joueurs qui ne voulaient pas d’elle dans le vestiaire qu’elle était là pour de bon dans ce monde.
Machabée n’est pas la seule. Avant elle, Claudine Douville est l’une des premières à avoir défié le fameux boys club. Même si elle n’a à priori rencontré personne en costume d’Adam dans les vestiaires, Douville a su imposer sa présence dans un milieu qui ne voulait pas d’elle, avec assurance et détermination. Elle a raconté à Radio-Canada qu’il y a plus de 40 ans, personne n’avait envie qu’elle commente le soccer. Celle qui est aujourd’hui considérée comme « la voix du soccer et de la coupe du monde » à la chaîne du Réseau des sports a couvert pas moins de 46 disciplines sportives.
Pratiques répandues dans le monde
Le combat est loin d’être spécifique au Canada. Mes recherches pour cette chronique m’ont permis de rencontrer Mejdaline Mhiri, journaliste indépendante ayant travaillé pour le magazine français Les Sportives. Dans une entrevue accordée à ce média, Mhiri raconte une expérience qui a marqué sa carrière : « Dès mon tout premier stage, un journaliste du Parisien, que je connaissais à peine, m’a contactée à la fin de mon stage en me proposant d’aller à New York avec lui. J’ai d’abord pensé que c’était pour couvrir l’US Open, ce qui m’a enthousiasmée, mais j’ai vite compris que ses intentions étaient autres. C’était une déception, car j’avais cru que c’était pour le travail. Il y a quelques années, j’ai repris contact avec lui pour lui expliquer l’impact de son comportement, mais il ne comprenait pas. Cela m’a rappelé que dans ce métier, on est souvent ramenées à notre condition de femme. »
Dans un article du Journal de Montréal, Chantal Machabée raconte que sa « condition de femme » faisait qu’une partie des joueurs et du public ne la considérait pas comme compétente. Elle souligne que son apparence était scrutée : lorsqu’elle portait un col roulé, on lui reprochait d’être trop stricte, et si elle optait pour une chemise légèrement décolletée, on l’accusait de chercher l’attention. Les menaces de mort et de viols étaient malheureusement une partie de son quotidien.
Pressions mentales
Après avoir découvert toutes ces histoires, je ressens une pression à me dépasser et à être irréprochable. En tant qu’aspirante journaliste sportive, je m’impose moi-même cette exigence, car je refuse de donner raison aux sceptiques. Par exemple, lorsque j’ai couvert la compétition Capital Hoops, j’ai remarqué le regard admiratif des jeunes filles dans le public, comme si j’étais une célébrité. C’est à cet instant que j’ai pris pleinement conscience de l’importance de mon rôle, ce qui a renforcé encore davantage cette pression. Et je sais que je ne suis pas la seule à la ressentir. Les femmes déjà établies dans ce milieu portent un poids réel sur leurs épaules. En plus de défendre la cause des femmes, elles doivent répondre aux attentes de leur diffuseur et performer, comme tout journaliste, peu importe son genre.
Pourquoi les femmes journalistes subissent-elles de lourdes représailles pour une erreur, alors que, lorsqu’un homme commet la même faute, cela se limite à une simple remarque du type : « Fais attention, tu t’es trompé » ? Lorsqu’une femme se trompe, on remet immédiatement en question ses connaissances sportives et sa compétence, comme si elle n’avait pas sa place dans ce milieu.
La plupart du temps, lorsque je dis que je veux devenir journaliste, on me félicite, on me pose des questions, puis vient LA phrase : « Ah, tu es belle, donc c’est un avantage. » Je soupire, je souris et je réponds que c’est mon talent, mon travail et mon parcours universitaire en journalisme qui me mèneront à mon objectif, pas mon apparence. Je comprends l’intention derrière ces mots, mais il est temps d’arrêter de croire que les femmes journalistes doivent leur place à leur physique.
