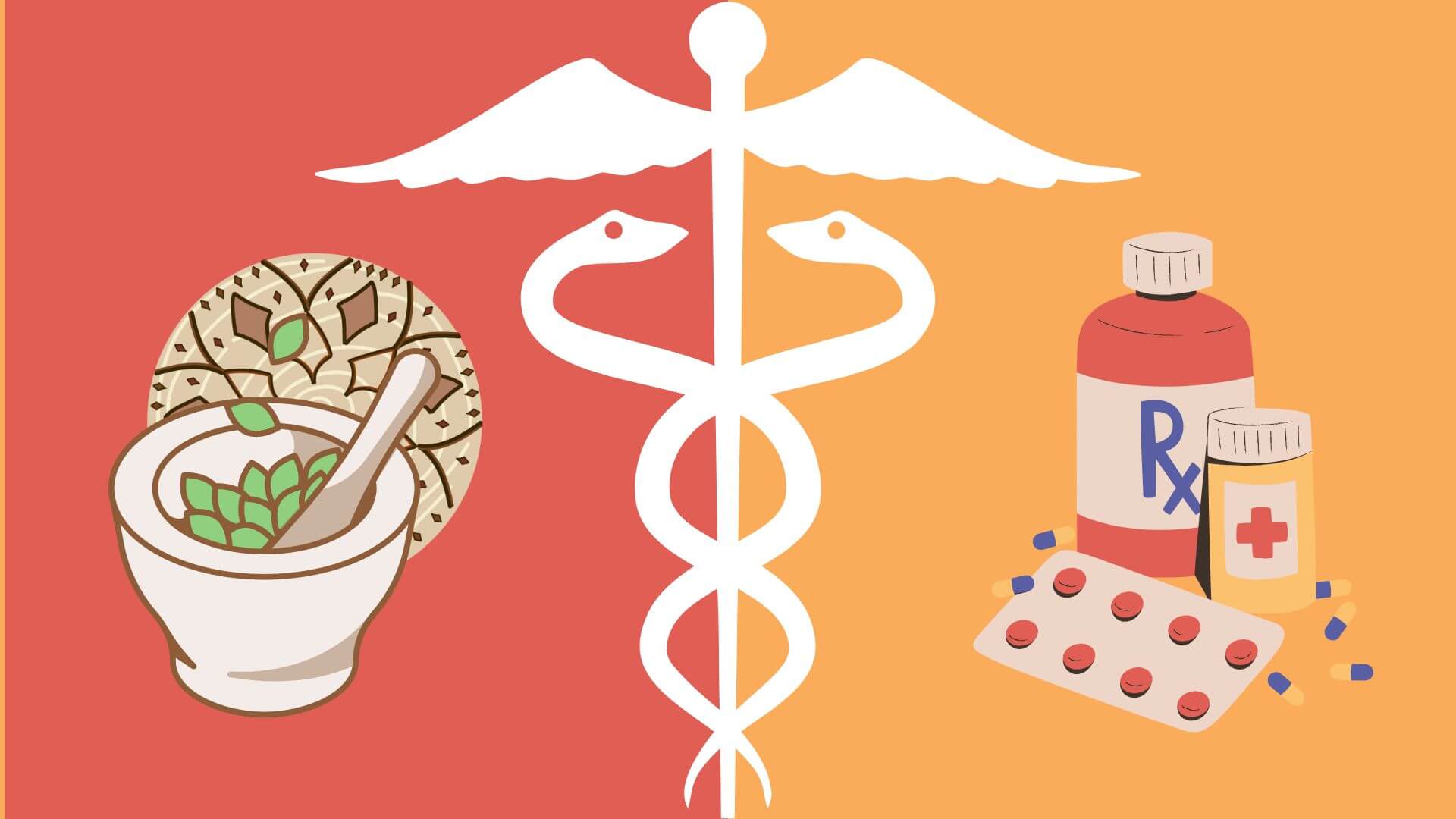
Entre médecine autochtone et « occidentale », une réconciliation possible ?
Crédit visuel : Dawson Couture – Rédacteur en chef
Article rédigé par Jacob Hotte – Journaliste
La médecine traditionnelle autochtone, utilisée communément à l’époque précoloniale dans les Amériques, est aujourd’hui négligée et catégorisée comme une alternative par la médecine « occidentale ». Malgré cela, son existence, encore en croissance dans les pratiques de plusieurs communautés des Premières Nations, semble représenter un symbole d’espoir pour certain.e.s en ce qui concerne la réconciliation et la décolonisation.
Des pratiques complémentaires ?
En ce qui a trait à la différenciation entre la médecine traditionnelle autochtone à la médecine « occidentale », Dre Darlene Kitty souligne que l’approche utilisée par les pratiques autochtones peut être décrite comme étant plus inclusive. La directrice du programme autochtone de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa explique que les pratiques traditionnelles de guérison des Premières Nations sont souvent orientées vers une démarche holistique, soit l’intégration de l’âme, de l’esprit, des émotions et du corps à leurs méthodes.
Jolianne Ottawa, directrice des services de santé au Centre de Santé Masko-Siwin, partage le même avis. Elle élabore sur le fait que la médecine traditionnelle autochtone ne se contente pas de guérir un seul aspect, mais se concentre davantage sur l’ensemble de la personne lors des traitements, selon la roue de médecine, un symbole important dans les pratiques de guérison autochtones.
Par cela, la docteure Kitty laisse entendre que la médecine autochtone peut apporter plus de pouvoir afin de produire un meilleur niveau de santé et de confort chez l’individu, par rapport aux techniques de soins dites « occidentales ». Les cliniques de soins autochtones en Ontario, dont les centres d’accès aux services de santé pour les Premières Nations, offrent ainsi une combinaison de divers types de médecine. Cela offre l’opportunité aux patient.e.s de choisir entre la médecine « occidentale », la médecine traditionnelle autochtone ou encore un mélange des deux, exprime-t-elle. C’est une réalité qui, selon Ottawa, serait similaire à celle du Québec où cette liberté de choix est aussi offerte.
La présence de programmes universitaires de médecine pour les Premières Nations, ainsi que la croissance de l’accessibilité des pratiques autochtones en milieu médical facilitent, l’appréhension des coutumes et des traditions autochtones, selon Kitty. Elle ajoute que ces initiatives sont un pas dans la bonne direction afin de pouvoir atteindre la réconciliation. Elle décrit l’intention du programme en médecine comme étant de cibler la compréhension des divers facteurs importants reliés à la santé des communautés autochtones par l’apprentissage d’enjeux sociaux et démographiques. Ottawa, quant à elle, énonce que ces programmes permettent la présence de personnes autochtones au sein des cohortes étudiantes, tout en promouvant le savoir ancestral et culturel chez les nouvelles générations.
Une pratique discréditée ?
Il existe un grand potentiel de collaboration entre les deux pratiques, qui ne sont toutefois pas clairement identifiées. Les deux spécialistes de la santé rapportent qu’il arrive que certaines pratiques de « l’Ouest » empruntent déjà beaucoup de leurs techniques des traditions autochtones. L’utilisation de plusieurs plantes dans la médication est en fait le produit du savoir des communautés autochtones, expliquent-elles. Malgré sa contribution à cette médecine dominante, le savoir traditionnel autochtone reste discrédité et dévalorisé, et sa participation à la médecine « courante » n’est pas reconnue.
En ce qui concerne l’acceptation des pratiques ancestrales, Kitty informe que cela peut permettre aux communautés autochtones d’avoir accès à une pratique médicale qui s’aligne mieux à leurs besoins culturels et spirituels. Selon elle, comprendre le passé et les enjeux sociaux qui ont un impact sur les Premières Nations encore aujourd’hui pourrait permettre d’offrir à ces dernières un meilleur accès aux services médicaux. Cela est notamment possible, selon elle, grâce à l’existence d’initiatives comme les programmes autochtones dans les Facultés de médecine universitaires.
De son côté, la directrice des services de santé révèle que ces initiatives permettent aux peuples autochtones de revendiquer leur souveraineté en repoussant la mentalité coloniale qui leur a été imposée. Par la réappropriation de ces connaissances, il serait alors possible aux Premières Nations d’acquérir une forme d’indépendance envers les services de soins de santé, enchaîne-t-elle.
Il existe néanmoins toujours plusieurs obstacles qui empêchent cette réalisation, dont le refus de reconnaître le racisme systémique par le gouvernement de François Legault. Sans cela, plusieurs s’inquiètent par rapport à la possibilité de progrès à l’intérieur du secteur de la santé.
