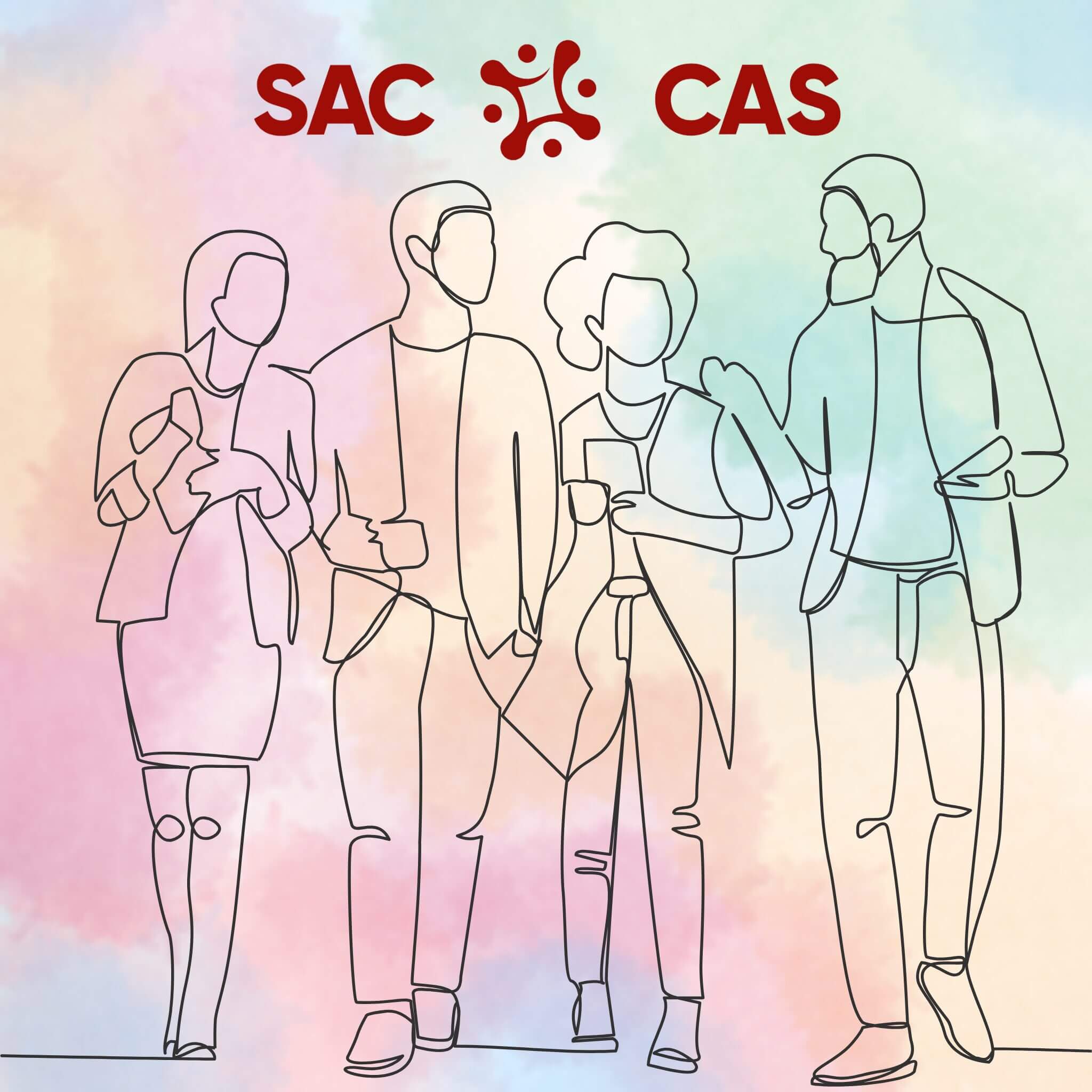
Dans les coulisses des clubs de l’Université d’Ottawa
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Article rédigé par Charlie Correia — Journaliste
L’Université d’Ottawa (U d’O) compte près de 350 clubs étudiants, qui organisent plusieurs types d’événements et se répartissent dans divers secteurs, comme la politique, la religion ou les arts. Le Service d’Administration des Clubs s’occupe de la gestion de ces clubs. Mais comment intégrer un club, et que recherchent ces regroupements ?
Pour joindre un club
C’est à travers le Portail des clubs, hébergé sur le site du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO), que les étudiant.e.s de l’U d’O peuvent explorer toutes les possibilités qui leur sont offertes. Allant des clubs académiques aux clubs philanthropiques, en passant par les clubs sportifs, il y en a pour tous les goûts. Les filtres de recherche s’avèrent utiles pour trouver un club qui correspond aux besoins de l’étudiant.e. Une fois le choix effectué, l’étudiant.e peut amorcer une demande d’adhésion, qui diffère d’un club à l’autre.
De nombreux clubs utilisent un formulaire à remplir afin de les rejoindre. C’est le cas de l’Association des étudiant.e.s internationaux.ales (AÉI) de l’U d’O. Son vice-président, Amine El Idrissi, précise que ce formulaire est accessible via les médias sociaux du groupe.
Pour d’autres clubs, le lien vers le formulaire se trouve directement sur le site du Syndicat, comme pour Achezzo Acappella, un club réunissant les passionné.e.s de la musique vocale. Le groupe interprète des chansons en français et en anglais, bien qu’être bilingue ne soit pas une exigence pour les rejoindre, précise leur formulaire.
Certaines organisations enfin, à l’instar de la Ligue d’improvisation étudiante universitaire (LIEU), exigent un processus d’audition. Benjamin Lefebvre, président de ce club d’improvisation en français, explique que la LIEU comprend quatre équipes d’environ six joueur.se.s. Les capitaines sont élu.e.s à la fin de la saison, puis sélectionnent les membres de leur équipe.
S’engager ensemble, grandir ensemble
Les clubs poursuivent plusieurs objectifs : s’impliquer dans un projet collectif, développer ou renforcer un sentiment d’appartenance entre les membres, rencontrer de nouvelles personnes, ou encore développer son réseau social et professionnel, d’après El-Idrissi. « On veut créer un espace où les étudiant.e.s peuvent se retrouver, et essayer de sortir un peu de la routine dans laquelle on peut facilement s’enfermer en tant qu’étudiant.e », poursuit-il.
Nafissa Ismail, professeure en psychologie à l’U d’O, rappelle que l’humain est un être social, ayant besoin d’interactions sociales pour bien fonctionner. « Quand on se retrouve seul.e, cela nous met dans un état de stress chronique, qui a des impacts sur notre santé physique et mentale », souligne l’experte.
Sur le plan psychologique, la professeure en psychologie explique que ce sont surtout les étudiant.e.s en première ou deuxième année qui sont attiré.e.s par les clubs. Selon elle, ces années marquent une période de transition intense : entrer à l’université signifie souvent plonger dans un environnement complètement nouveau, avec une façon d’apprendre plus autonome et exigeante.
Les étudiant.e.s doivent faire preuve de beaucoup plus de responsabilité, et nombreux.ses sont ceux et celles qui se sentent seul.e.s, isolé.e.s, ou ne savent pas comment accéder aux ressources offertes par l’université, constate-t-elle. C’est dans ce contexte que les clubs jouent selon elle un rôle clé, en brisant l’isolement, en facilitant l’intégration et en informant sur les services disponibles.
« Ces regroupements permettent aux étudiant.e.s d’appartenir à un groupe qui partage leurs valeurs et leur manière de penser. Et à long terme, cela contribue à une meilleure adaptation au milieu universitaire », précise Ismail.
Le sentiment d’appartenance joue également un rôle central dans le bien-être étudiant. Ismail souligne que les étudiant.e.s qui ne se sentent pas intégré.e.s « sont souvent très isolé.e.s, ont des difficultés académiques, n’ont pas le goût de venir à l’université, n’ont pas le goût de faire leurs travaux ». À l’inverse, ceux.celles qui ressentent un véritable lien avec leur campus — que ce soit grâce aux clubs ou d’autres formes de communauté — ont généralement une meilleure santé mentale, affirme-t-elle.
C’est dans cette optique d’ouverture et de renforcement du sentiment d’appartenance entre leurs membres que l’AÉI accueille également des étudiant.e.s canadien.ne.s, renseigne El Idrissi.
Un couteau à double tranchant
La professeure met cependant en garde : les études ou le travail ne doivent pas être négligés au profit d’une implication parascolaire trop prenante. Elle souligne que ces activités peuvent parfois désorganiser l’horaire de l’étudiant.e, réduisant le temps disponible pour les études ou pour soi-même.
« Parfois, on devient tellement absorbé.e.s par les clubs que cela finit par nuire à la réussite scolaire », indique-t-elle. Elle raconte avoir vu des étudiant.e.s en difficulté être contraint.e.s de quitter leur programme, faute d’un bon équilibre entre engagement social et exigences académiques.
Selon la professeure, il est primordial de bien organiser son emploi du temps et de ne pas hésiter à se fixer des limites pour prioriser ses études. « Il faut bien planifier son temps. Faire un calendrier de sa semaine, établir ses priorités, c’est-à-dire les cours, les temps d’étude, puis se demander combien de temps il reste pour les clubs », conseille-t-elle. L’important, selon elle, est d’arriver à bien gérer son temps et à établir une routine pour que les clubs restent un plaisir, et non une charge supplémentaire.
