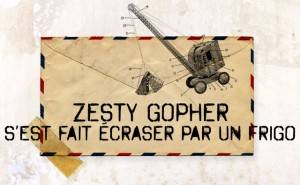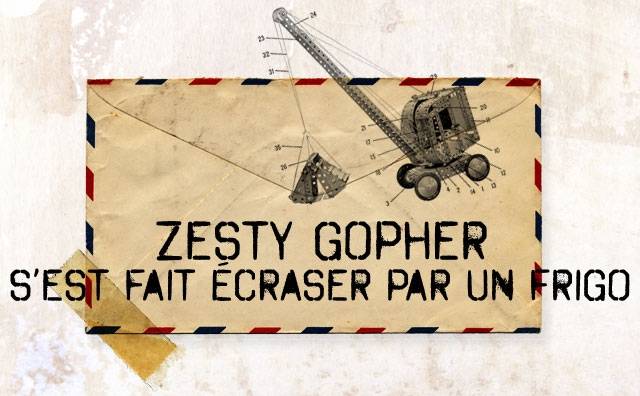
Critique de théâtre : Retour sans pompe de Thomson Highway, au CNA pompe de Thomson Highway, au CNA
– Par Laurent S. Bouchard –
Le 17 octobre dernier, le Centre national des Arts (CNA) a présenté la première de la pièce Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo, une adaptation de la pièce de l’auteur canadien, Thomson Highway. La Rotonde vous fait la critique de la plus récente pièce mise en scène par une ancienne de l’Université d’Ottawa, Geneviève Pineault.
Une adaptation musicale et linguistique
C’est une pièce originellement intitulée The (Post) Mistress que Pineault s’est chargée de transformer en août 2011. La traduction, assurée par Thomson Highway et son compagnon Raymond Lalonde, épaulés par Robert Marinier, a pris plusieurs mois. Ils ont travaillé à six mains, s’attachant à conserver l’esprit du texte ainsi que sa musicalité, la moitié du texte étant d’ailleurs chanté ou fredonné. Des répétitions de chant, du texte, et de la chorégraphie se sont succédés pendant les huit semaines précédant le jour de la première.
La maîtresse des postes, seul personnage sur scène, a été interprétée par Patricia Cano, une habituée de Thomson Highway. La comédienne a partagé la scène des cabarets avec lui et connaît la langue Cri, importante dans la pièce. La mise en scène comportait des objets aux utilités doubles, comme le piano qui s’allongeait afin de former le comptoir, ou les boîtes où sont déposées les lettres qui pouvaient se transformer en escalier.
La trinité du sexe, de l’amour et de la mort occupe une place prépondérante dans la pièce, par l’entremise du personnage de Patricia Cano qui se révèle, à bien des égards, une colporteuse qui ne se « mêle pas de ses affaires ». Elle affirme d’ailleurs à son auditoire qu’elle connaître ainsi les secrets de son village et des autres bourgades environnantes. Au fil de la pièce, on navigue entre le comique et le tragique, des histoires légères laissant place à d’autres plus sérieuses.
Une torpeur en deux actes
La structure de la pièce en deux actes est ambitieuse mais n’a malheureusement pas remplit les attentes car, si l’interprète a su merveilleusement bien chanter, avec une voix ronde et qui porte, son parler français était quelque peu imprécis. Son anglais et son espagnol se sont en revanche avérés impeccables. Par moment, la pièce étant principalement en français, il peut devenir fatiguant pour le spectateur de passer sans cesse d’une langue à l’autre. L’interprète a par ailleurs manqué de maîtrise sur la durée, et son retour de l’entracte l’a vue moins exubérante. La chorégraphie parfois carnavalesque a bien servi le texte mais a dévoilé également l’inégalité du ton.
Tout d’abord joviaux, les éclats de passion et l’humour représentés en pourpre et en écarlate sur l’écran en arrière-scène ont laissé place à des histoires plus tristes exprimées par un éventail de couleurs, du marine au beige en passant par le marron. Le tout était visuellement stimulant mais, tristement, sans apparente logique. Le premier acte s’est achevé, laissant une idée bien maigre quant au ton du second. Faute de suspense, le couple à ma gauche a d’ailleurs décidé de quitter le spectacle à l’entracte.
Après une heure et demie de commérages imaginaires et le constat que les numéros musicaux les plus stimulants avaient eu lieu au début de la pièce, la salle s’est retrouvée dans un état de torpeur. Le ton de la pièce avait d’ailleurs radicalement changé, et on en apprenait désormais plus sur la maîtresse de poste et son histoire personnelle, passage qui s’est avéré manquer d’humour, contrairement au premier acte. L’amour, devenu pourtant l’élément central de la pièce, manquait de souffle. La chute a été semblable à un nettoyage à tâtons des miettes suivant une explosion paroxystique : gênant… Si bien que personne n’a vraiment tenu à s’en extasier.
En somme, il s’agit d’une pièce imaginative mais trop lourde. L’interprète a peiné à rendre l’émotion parfois trouble du texte, mais a rayonné dans les épisodes où elle a été amenée à chanter. Le saxophone a par ailleurs été bien peu utilisé, lors d’un seul solo qui a frôlé la minute et des épanchements à demi-souffle derrière le piano. L’inclusion de la langue cri s’est également avérée curieuse, quoique percutante : à plusieurs moments, la comédienne a ainsi récité ou chanté avec des sous-titres apparaissant sur l’arrière-scène, ce que je n’ai découvert que bien trop tard pour en profiter, à la fin du deuxième acte. Cette petite erreur est symptomatique de la pièce : de bonnes idées, certes, mais trop espacées, mal reliées et en pagaille.