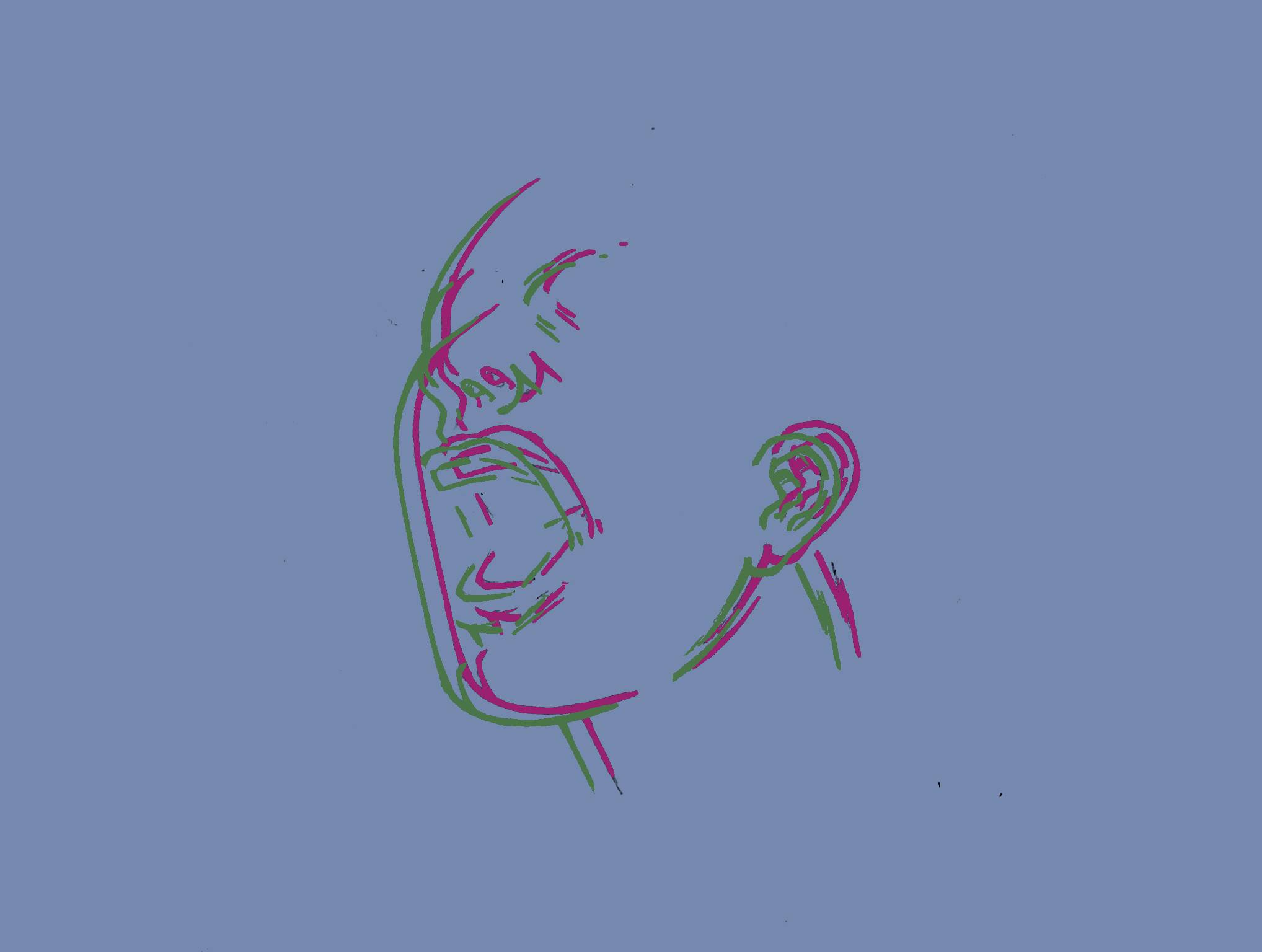Par Emmanuelle Gingras, cheffe du pupitre arts & culture
Alors que l’année chemine vers sa fin, je crois que deux débats ont particulièrement animé les médias concernant les arts. Des discussions qui selon moi ont omis de considérer certains angles…
Les limites de la liberté d’expression
Robert Lepage se faisait taire cette année avec son spectacle Kanata. Un « recul de la liberté artistique [qui est] intolérable », comme s’est révolté le chef du parti québécois, Jean-François Lisée, sur Twitter en juillet dernier. Une lettre envoyée au journal Le Devoir de la part d’un regroupement autochtone soulignait à nouveau avoir été représenté sans eux et ce, en dépit de leur capacité à culturellement enrichir la scène. La discussion a donc été initiée : quelles sont les limites de la représentation culturelle sur scène ? Ce n’est pourtant qu’après avoir écouté la mise en lecture d’Al Jarat Ingrates, reprise de la pièce Les Belles-sœurs selon un dialogue culturel maghrébin, que le débat s’est compliqué pour moi. À la Nouvelle Scène Gilles-Desjardins, Éric Beevis nous présentait une douzaine de femmes, elles-mêmes maghrébines, sur scène. Particularité : pas une d’elle n’était actrice. N’y avait-il pas moyen de recruter des actrices arabes dans la région ? Semblerait qu’elles se font relativement rares ! Ce qui engendre la question suivante : et si les minorités visibles se faisaient moins voir sur scène puisqu’elles sont moins nombreuses en terme de chiffres dans la communauté artistique ? Je pense qu’il est ainsi à considérer une couche que plusieurs semblent oublier dans un tel débat : qu’est-ce qui crée ce phénomène ? Comment atteindre des communautés qui se battent pour leur survie économique et pour leur adaptation ? L’art ne devient qu’occasion et élitisme. Pourrions-nous ici discuter d’une lacune de ce côté-là qui est, selon moi, quand même très politique ?
Ottawa, let’s go réveille !
Il est impossible de ne pas souligner les dernières coupures fordiennes dans ce résumé de l’année. Je crois que cette simple action n’a eu d’autre conséquence que d’unir les artistes francophones de la région. La Rotonde abordait, entre autres, il y a quelques semaines, le nouveau recueil tumultueux unissant des poètes franco-ontariens révoltés, La Lumière de notre colère. Lors d’une soirée de récitation intitulée Oser la Résistance, le bistro-bar Gainsbourg accueillait, dans le cadre du Salon du livre de l’Outaouais, des poètes avec le même emballement que Michèle Lalonde et son fameux poème Speak White. J’ai pu sentir une énergie, un désir d’être entendu. Alors qu’attendent les gens pour l’être ? « Nous sommes, nous serons » ? Nous serons lorsque du changement se produira. Faut-il attendre un autre scandale comme le spectacle MILF pour faire parler les Franco-Ontariens ? Remède rafraîchissant côté nouveautés, selon moi, pour une communauté artistique qui s’intéresse bien trop à sa crise linguistique.
Je crois qu’il faut créer au-delà de ça. Être reconnu pour autre chose que cela. C’est un enjeu, certes, mais pourquoi les coupures de Ford ont-elles dû avoir lieu pour qu’on parle enfin des Franco-Ontariens ? Les gens peuvent s’unir, loin de Ford, et être ingénieux sans « excuses » pour être reconnus.
Les communautés artistiques existent à Ottawa, mais elles semblent timides. Voilà, le local d’ici est silencieux. Je n’ai rien contre l’humilité, mais le désir de se faire reconnaître ne semble pas si présent dans la région. Ce n’est que par la distinction qu’une réelle écoute sera faite à la culture et surtout que celle-ci se répandra. Je n’arrive plus à compter le nombre de fois que j’ai entendu dire : « le Québec prend toute la place ». Et bien, osez être reconnus !Cessons d’accueillir des grands noms sur nos scènes, soyons les grands noms ! Que les gens se réunissent, qu’ils idéalisent, qu’ils explorent, qu’ils commettent, qu’ils réfléchissent, qu’ils osent ! Qu’ils soient la voix d’une nouvelle forme d’audace.
Besoin d’une révolution artistique ?
Pour revenir à un avis plus général sur l’art en soi, je dirais que c’est toujours un appel à la révolution que nous semblons nécessiter. Je ne vois plus, dans ce tumulte de déjà-vu, une issue de distinction. Quand je parle de distinction, je ne la soulève pas qu’à de purs intérêts esthétiques, mais parce que je crois que les scandales artistiques sont des reflets de ce qui se produit out there. Et ce out there, c’est la politique, l’économie, le social. J’ai cette vague impression de stagnation. Certes, quelques audaces ici et là viennent insurger, mais où est l’art qui scandalise un monde ? J’aimerais bien la folie, l’impardonnable ; cela voudrait dire qu’il y a discussion et réflexion, qu’il y a mouvement dans le monde. Peut-être est-ce le plus grand problème de l’actuel ? Il se refuse à la nouveauté et se bâtit et se forge de roc tel un grand nœud impossible à défaire pour qu’on le laisse enfin tranquille. Une petite survie de surface avec ça ? Bon, il est vrai que l’art n’est pas timide, il connaît ses controverses, mais peut-être connaît-il un peu trop les mêmes ? Je me demande simplement quand se présentera la porte de sortie à cette salade de crise existentielle sur le plan artistique. Cette panoplie excessive de courants mène à un tumulte encombrant et il devient difficile de savoir où porter l’œil.